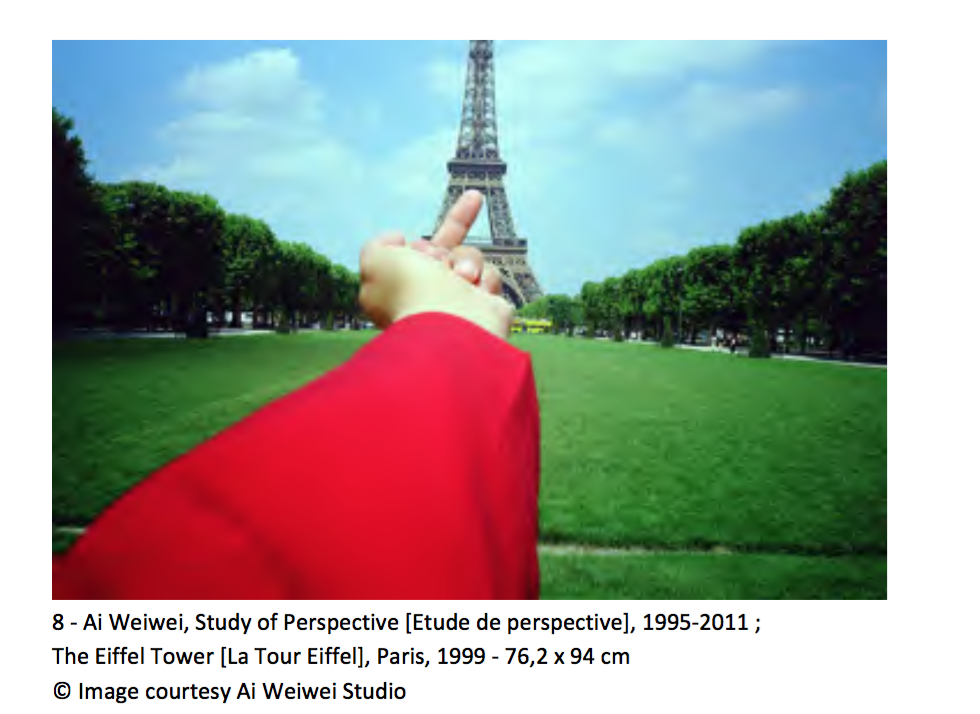Entretien avec Judith Benhamou-Huet, commissaire de l’exposition
« L’artiste et le musée partagent une matière première commune : l’observation du quotidien. »
Pourquoi Ai Weiwei est-il considéré comme l’un des plus grands artistes de la scène contemporaine ?
C’est un artiste complet, dans le même esprit qu’Andy Warhol : il crée à la fois des formes – c’est un héritier des artistes surréalistes et de Marcel Duchamp – mais investit aussi de nouveaux domaines, comme les médias sociaux, où il est très efficace. Il appartient pleinement à notre époque et sait communiquer avec les moyens du XXIe siècle : il a ainsi su s’emparer des réseaux sociaux, comme Andy Warhol a pu le faire en son temps, notamment avec la télévision. Enfin, il est un pont entre la culture occidentale et la culture chinoise, même s’il s’est opposé de manière évidente au gouvernement chinois. Son courage a d’ailleurs eu un effet d’exemplarité.
En quoi son œuvre se rapproche-t-elle des thématiques explorées par le Mucem ?
Le Mucem est un musée de société, et ses collections témoignent de la vie quotidienne : elles nous racontent la manière dont on se nourrit, dont on se divertit, dont on se vêtit, ce en quoi l’on croit… Ai Weiwei, selon les principes de Duchamp, reprend cette même approche en s’intéressant à des objets du quotidien qu’il transforme en œuvres d’art. L’artiste et le musée partagent donc une matière première commune : l’observation du quotidien.
À travers cette exposition à Marseille, il revient aussi sur les pas de son père…
Ai Qing, le père d’Ai Weiwei est l’un des grands poètes de la modernité chinoise. Pour parvenir à créer cette modernité, il s’est frotté aux idées de l’avant-garde en France à partir de 1929. Avant d’aller à Paris, son premier contact avec l’Occident fut le port de Marseille, où il a débarqué. Il a d’ailleurs écrit un poème magnifique décrivant le chaos marseillais de cette époque. La cité phocéenne était alors considérée comme un lieu de modernité, notamment pour son fameux pont transbordeur, véritable monument moderniste à l’architecture métallique, qui intéressa de nombreux photographes de l’époque, comme Germaine Krull ou László Moholy-Nagy. Marseille était alors la « porte de l’Orient ». Ai Qing est donc arrivé par les quais de la Joliette. On se devait de rendre hommage à ce poète qui a, pendant la révolution culturelle chinoise, été exilé de force vingt ans dans le nord du pays avec pour tâche principale le nettoyage quotidien des toilettes communes d’un village… Ai Weiwei est né à cette époque, et j’imagine que c’est là que réside le point de départ de sa révolte et de son refus de l’injustice.
Comment s’est déroulée la préparation de cette exposition ?
Ai Weiwei est venu l’été dernier à Marseille pour découvrir les collections du Mucem et trouver des résonances avec son œuvre. Nous sommes, entre autres, allés sur les traces de son père. Nous avons visité le port marchand où celui-ci avait débarqué, puis la chambre de commerce et d’industrie, où nous avons retrouvé le carnet de bord du bateau sur lequel il avait voyagé. Cela a particulièrement ému Ai Weiwei.
L’exposition met en parallèle des œuvres d’Ai Weiwei avec des objets des collections du Mucem. Quelles correspondances avez-vous pu mettre en évidence ?
Elles sont de différents ordres. Ai Weiwei s’intéresse beaucoup à la culture chinoise et à la perception des Chinois par l’Occident. Dans les collections du Mucem, nous avons pu trouver un grand nombre de ce que l’on appelle des « cartes-réclames », du début du XXe siècle. À l’époque, un sentiment xénophobe qualifié de « péril jaune » se développait en Europe, dans un contexte de recherche de nouveaux débouchés commerciaux des Occidentaux, qui avait amené à la première et à la deuxième guerre de l’opium. Cela avait entraîné des révoltes de la part de la population locale. Les Chinois étaient alors considérés par les Européens comme des barbares ; et ces cartes-réclames faisaient ainsi l’apologie du soldat français en territoire chinois. On les trouvait dans des produits de consommation comme le chocolat – ce qui nous permet de distinguer une forme de propagande politique à travers des objets du début de la société de consommation. C’est un exemple, parmi beaucoup d’autres, du type d’objets qui intéresse Ai Weiwei…
Il s’agit de la première grande exposition consacrée à Ai Weiwei en France. Quelles sont les pièces majeures qui seront présentées ? A-t-il créé des œuvres spécialement pour cette exposition ?
Il y a déjà eu une exposition au Jeu de Paume, à Paris, en 2012, mais celle-ci présentait son œuvre de photographe et d’animateur des réseaux sociaux. L’exposition du Mucem est en effet la première de cette importance, en France. Elle est exceptionnelle à deux titres : d’une part, elle présente des pièces réalisées par Ai Weiwei dans les années 1980, lorsqu’il vivait à New York ; un travail inédit, encore rarement montré. D’autre part, il a en effet créé de nouvelles pièces pour cette exposition, notamment des œuvres en savon de Marseille. Parmi les autres pièces notables, nous pouvons citer la reconstitution d’un temple chinois, ou encore cet immense lustre, créé pour l’exposition selon la méthode du ready-made de Duchamp, mais en y ajoutant une dimension esthétique et une certaine monumentalité : il est en effet constitué d’un ensemble de lustres. En Chine, tous les hôtels qui fleurissent aujourd’hui redoublent de luxuriance avec leurs lustres toujours plus clinquants, plus grands. Il s’agit donc d’un objet « post ready-made », mais aussi d’une référence au nouveau capitalisme chinois.